
Alice Munro (Phot The New Yorker)
Le 02 janvier 2014, à la gare de Lille d’où je quittais mon Nord, j’ai acheté Fugitives (Runaway) (2008), un recueil de nouvelles de l’écrivain d’un autre Nord, la Canadienne Alice Munro (Prix Nobel de Littérature 2013). J’ai été happée par les huit histoires qui racontent les fuites désirées mais toujours avortées de ses héroïnes féminines, dans le cadre des années 60. J’ajouterai que la traduction par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso en est remarquable.
La nouvelliste possède au plus haut degré l’art de conter en un minimum de pages ces moments intenses où tout pourrait basculer, changer, infléchir le cours d’une vie. Mais les habitudes, le manque de courage, le hasard, font rentrer ses héroïnes dans le rang.
La première nouvelle, qui donne son titre à l’ensemble du recueil, est ainsi emblématique de l’atmosphère mélancolique et douce-amère de l’œuvre. Carla, qui travaille avec son mari Clark dans un centre équestre, se décide un jour à partir pour « prendre en charge sa propre vie ». Elle n’ira pas jusqu’au bout de son voyage car elle s’interroge soudain en pensant au regard de son mari sur elle: « Mais qu’est-ce qui compterait pour elle ? Comment saurait-elle qu’elle était vivante ? » Tout comme sa petite chèvre Flora qui avait disparu peu de temps avant sa propre fuite, elle revient au bercail. Mais que deviendra-t-elle ? Le soir, à la lisière des bois, « c’était comme si une aiguille meurtrière s’était logée quelque part dans ses poumons et qu’en respirant prudemment elle pouvait éviter de la sentir. » Et elle se dit qu’ « il n’y avait peut-être rien là-bas ».
Les trois nouvelles suivantes, « Hasard », « Bientôt » et « Silence », racontent les grandes étapes de la vie de Juliet, une jeune doctorante en Lettres classiques qui « va catastrophiquement bien ». La première nouvelle conte sa rencontre dans un train avec Eric, un pêcheur qui deviendra son compagnon. Elle s’opère alors que la jeune femme éprouve un intense sentiment de culpabilité à la suite du suicide sur la voie d’un passager que Juliet vient d’éconduire. L’ « Affreux Bruit Sourd » la poursuivra longtemps.
« Bientôt » met en scène son difficile retour au domicile de ses parents, Sam et Sara, en compagnie de sa fille Pénélope, âgée de treize mois. Elle comprendra qu’elle n’aurait jamais dû y revenir : sa mère sombre dans la maladie d’Alzheimer, son père s’est entiché d’Irène la femme de ménage, le pasteur lui reproche sa profession d’athéisme : « Elle songea qu’un déplacement avait dû intervenir à cette époque-là, et qu’elle ne se rappelait pas. Un déplacement concernant son foyer […] le lieu où elle avait été chez elle avant, toute sa vie d’avant. » Et surtout, elle a fait défaut à sa mère (« Elle n’avait pas protégé Sara »), sa mère qui ne semblait tenir bon que parce qu’elle se disait : « Bientôt, je verrai Juliet . »
Enfin, « Silence » évoque la douloureuse quête de Juliet après la disparition de sa fille Pénélope. Au Centre d’Equilibre Spirituel où elle croit retrouver sa fille, elle s’entend dire par la Mère Shipton que Penelope l’a quittée parce qu’elle était « affamée de choses qui ne lui étaient pas accessibles dans son foyer ». Juliet s’identifie alors à la reine d’Ethiopie de l’œuvre d’Héliodore, Ethiopiques. Après avoir confié sa fille aux gymnosophistes, elle part à sa recherche car elle a été enlevée par Théagène, un noble thessalien. Après le naufrage de son mari Eric, des hommes se succèderont auprès de Juliet. Sa vie se continue dans le silence et la solitude : « Elle espère comme les gens espèrent sans se faire d’illusion des aubaines imméritées, des rémissions spontanées, des choses comme ça. »
« Passion » se passe dans la vallée de l’Ottawa. C’est l’histoire de Grace, qui travaille dans un restaurant et dont Maury Travers tombe amoureux. A l’occasion de la célébration de Thanksgiving, elle se blesse au pied et est emmenée à l’hôpital par le demi-frère de Maury, Neil qui est médecin. Entre le jeune homme alcoolique et la jeune femme froide, c’est la révélation d’une reconnaissance intuitive, intime et secrète. Leur histoire ne durera que le temps d’une escapade où il lui apprend à conduire. Elle se terminera tragiquement. Et quand son fiancé Maury lui demandera : « Dis seulement que c’est lui qui te l’a fait faire. Dis seulement que tu ne voulais pas y aller », elle répondra laconiquement : « Je voulais y aller. »
« Offenses » retrace les angoisses de Lauren, la fille de Harry et Eileen. Le conseil que son père lui a donné, c’est d’ « être à l’écoute ». Elle ne le sera que trop en découvrant un carton qui renferme des cendres, dont son père lui explique qu’elles sont celles d’une petite fille morte avant sa naissance. Et on a aura beau dire à Lauren qu’elle fut la bienvenue au foyer de ses parents, le doute s’insinue en elle. Il sera entretenu par Delphine dont Lauren devient l’amie, celle-ci lui laissant entendre qu’elle a été adoptée et qu’elle serait sa fille biologique. Et même si elle lui répète « Tu n’as aucune raison de t’inquiéter de quoi que ce soit », la vie de Lauren en est bouleversée. Malgré d’ultimes révélations, Lauren sait que désormais « la seule chose à faire était de prendre son mal en patience ».
« Subterfuges » met en scène Robin, une infirmière de vingt-six ans, qui vit avec une sœur handicapée plus âgée, Joanne. Solitaire, « elle attendait voilà tout, comme si elle avait eu quinze ans, et n’était que par moments affrontée à sa vraie situation. » Chaque été, elle a pris l’habitude d’aller à Stratford voir au théâtre une pièce de Shakespeare. Cette année-là, elle rencontre l’horloger Danilo Adzic qui doit retourner momentanément dans son pays. Elle aura la chance « de se faire embrasser sur un quai de gare et se faire entendre dire de revenir dans un an ». Mais le hasard méchant déjouera ce projet amoureux et les subterfuges de Shakespeare- qui auraient pu l’alerter- ne lui serviront de rien. Ce jour-là, c’est à cause d’une robe verte que Robin se retrouvera seule pour la vie : « A cause de la femme de la teinturerie, de l’enfant malade, elle n’avait pas mis ce qu’il fallait. »
La dernière nouvelle, « Pouvoirs », se présente en partie sous la forme d’un journal, en partie sous une forme narrative à la 3ème personne, en partie encore sous forme de lettres. La narratrice, Nancy, qui travaille avec son père dans la scierie de ce dernier, appartient à un groupe de lecture et elle est plongée dans la lecture de La Divine Comédie de Dante. Comme elle « aurai[t] accepté une tasse de thé », elle accepte d’épouser Wilf, un médecin. A l’occasion de son mariage, elle fait la connaissance de Ollie, qui a subi un pneumothorax, et avec qui elle s’entend très bien : ils sont comme deux enfants. Elle rencontre aussi Tessa qui possède des dons divinatoires. Par la suite, on apprend que Tessa et Ollie se sont mariés et qu’ils ont vécu en utilisant les dons de Tessa et en se prêtant à des expériences pour la communauté scientifique. Le hasard remettra Nancy en présence de Tessa internée dans un centre psychiatrique et de Ollie, devenu alcoolique. En sa présence, elle éprouvera « une perplexité croissante, puis un sentiment de déception […] puis une tristesse envahir tout son être ». En le revoyant, Nancy comprend ce qu’elle a perdu : « Ils avaient reculé devant ce désir quel qu’il fût voilà bien des années, et il leur fallait certainement en faire autant à présent qu’ils étaient vieux – pas terriblement vieux, mais assez vieux pour sembler disgracieux et absurdes. » A la fin, pourtant, Nancy semble échapper à l’emprise des pouvoirs de Tessa et de Ollie sur elle : « On dirait que quelqu’un de calme et de décidé –s’agirait-il de Wilf ? – a entrepris de […] l’emmener doucement , inexorablement, loin de ce qui commence à se désagréger derrière elle, se désagréger et s’assombrir tendrement pour se résoudre en une apparence de suie, une douceur de cendre. »
Dans ce recueil, j’ai aimé ces êtres de fuite, ces femmes qui rappellent toutes la chanson des Beatles, « She’s leaving home ». L’écrivain saisit ses héroïnes dans cet entre-deux où elles ne savent plus très bien qui elles sont et ce qu’elles veulent vraiment. Certes, elle sont intelligentes, elles lisent - de Shakespeare à Tostoï en passant par Thomas Gray ou Wordsworth - elles sont courageuses. Mais il est en elles une faille comme ce « trou béant dans [l]a poitrine » de Robin et qui ne cesse de se creuser au fur et à mesure que les années passent. Alice Munro connaît l’art d’explorer les non-dits, les vacillement, les hésitations de la mémoire. Ainsi Juliet croyait que Penelope aimait son père quand, avec surprise, elle l’entend dire : « Bah ! je le connaissais à peine ! »
La novelliste canadienne dit aussi admirablement les moments-clés de l’existence : « Décrivant ce passage, ce changement dans sa vie, plus tard Grace aurait pu dire – et dit effectivement - que c’était comme si une grille s’était refermée à grand bruit derrière elle. » Il en va de même pour la force terrible du chagrin, tel que l’éprouve Juliet : « C’est donc cela le chagrin. Elle a l’impression qu’un sac de ciment déversé en elle a rapidement durci. »
Chez l’écrivain, j’ai admiré la maîtrise de l’emploi du flash-back qui permet de créer le puzzle émouvant de la vie de ses héroïnes. Passé et présent se mêlent avec complexité mais harmonie et recomposent une mémoire sensible qui a retenu une phrase, un détail, marquants, dans l'espoir de cerner ce que furent les êtres. Ainsi de son fils Neil Mme Travers n’avait-elle pas dit en citant Thomas Gray : « Il est profond comme les gouffres insondables de l’océan qui portent » ? Olivier Cohen (dans son article « Alice Munro a réinventé la nouvelle ») le souligne très bien : « C’est un écrivain d’une puissance exceptionnelle, avec une capacité d’évocation très forte. Elle met en lumière, d’une façon frappante, des personnages face à des choix de vie déterminants, - souvent liés à une relation amoureuse - , un peu comme le ferait un metteur en scène de théâtre. »
Alors que les nouvelles de Joyce Carol Oates (que j’aime aussi énormément) mettent en scène des héroïnes border-line ou victimes de terribles violences, Alice Munro nous propose des femmes tout ce qu’il y a de plus banales. Comme Carla, l’héroïne de la première nouvelle, elles éprouvent intensément « le besoin d’un genre de vie plus authentique ». Telle Juliet, elles ne cessent aussi de dire « j’aurais dû » ; à l’instar de Grace, elles ne veulent surtout pas être des poupées égoïstes « avec un pois chiche dans le cerveau ».
C’est ainsi qu’avec un art consommé d’une stylisation à la Tchékhov, Munro trace pour son lecteur des lignes de fuite jamais atteintes par ses héroïnes ; celles-ci n’en sont ainsi que plus vulnérables et plus émouvantes.
Fugitives, Alice Munro, Points, P2205

















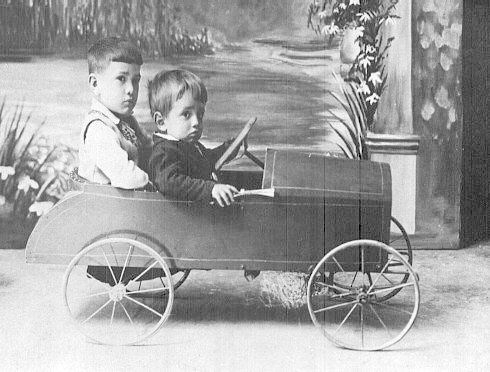





/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)
