 De gauche à droite : Michel Miramont, Silvio Pacitto, Jean Lespert
De gauche à droite : Michel Miramont, Silvio Pacitto, Jean Lespert
Vendredi 22 mars 2013, dans le cadre du festival saumurois des 1001 Voix, La voix parlée, la voix chantée… la voix imaginée, son directeur artistique, Silvio Pacitto, proposait 45 minutes consacrée à la poésie, à l’heure où le ventre crie famine. Sous les grands lustres hollandais et les lambris vernissés de la salle des mariages de l’Hôtel de Ville, devant un public d’une trentaine de personnes, les comédiens Jean Lespert, Michel Miramont et lui-même ont fait résonner les mots d’une petite dizaine de poètes de leur choix.
En un subtil dosage des textes, tour à tour, ils nous ont donné à entendre des tonalités variées. Jean Lespert a d’abord proposé la définition provocatrice de la démocratie par Romain Gary, en lutte contre le totalitarisme des idées :
« Je suis a priori contre tous ceux qui croient avoir absolument raison […] Je suis contre tous les systèmes politiques qui croient détenir le monopole de la vérité. Je suis contre tous les monopoles idéologiques. Je vomis toutes les vérités absolues et leurs applications totales. Prenez une vérité, levez-la prudemment à hauteur d’homme, voyez qui elle frappe, qui elle tue, qu’est-ce qu’elle rejette, sentez-la longuement, voyez si ça ne sent pas le cadavre, goûtez en gardant un bon moment sur la langue- mais soyez toujours prêt à recracher immédiatement. C’est cela, la démocratie. C’est le droit de recracher. »
Avec les alexandrins charpentés de Victor Hugo, Silvio Pacitto a rappelé le grand rêve de son poème « Fraternité »:
« Je rêve l’équité, la vérité profonde,
L’amour qui veut, l’espoir qui luit la foi qui fonde,
Et le peuple éclairé plutôt que châtié.
Je rêve la douceur, la bonté, la pitié,
Et le vaste pardon. De là ma solitude. […] »
L’absurde était aussi au rendez-vous quand Michel Miramont et Silvio Pacitto ont entamé le « Dialogue sur un palier », extrait du Gobedouille et autres diablogues de Roland Dubillard. Comment, à partir d’un banal pied qui craque, on en vient à s’interroger sur l’existence d’un petit oiseau, ampoule ou gobedouille. Extraordinaire inventivité d’un auteur qui a l’art de métamorphoser une situation simple en imbroglio poétique.
Quant à Michel Miramont, il a proposé à notre sagacité les « Petits problèmes et travaux pratiques » du Professeur Froeppel de Jean Tardieu, lesquels nous ont laissés perplexes :
« I. L’espace.
Etant donné un mur, que se passe-t-il derrière ?
Quel est le plus long chemin d’un point à un autre ?
II. Problème d’algèbre à deux inconnues.
Etant donné qu’il va se passer je ne sais quoi je ne sais quand, quelles dispositions prenez- vous ?
III. Deux mots de mécanique rationnelle.
Une bille remonte un plan incliné. Faites une enquête. […] »

Michel Miramont
Nous avons encore souri avec amertume avec « La complainte de l’homme exigeant » du même Jean Tardieu, toujours choisi par Michel Miramont. Mélancolique complainte d’un homme qui « veu[t] faire la lumière/ sur « la sale affaire de [sa] vie ». Ainsi, à cors et à cris, il « réclamait le soleil/ Au milieu en plein milieu/ De la nuit (voyez-vous ça ?) » :
« Or malgré tous nos efforts
Nous n’avons pu lui donner
La plus petite parcelle
De la lumière solaire
Au milieu de la nuit noire
Qui le couvrait tout entier.
Alors pour ne pas céder
Alors les yeux grands ouverts
Sur une toute autre lumière
Il est mort. »

Silvio Pacitto
Avec « La Cigale et le Renard », fable moderne retenue par Silvio Pacitto, la plume sarcastique d’Anouilh, nous a rappelé le pouvoir de l’argent roi : une fable où le dupeur se voit dupé par plus malin que lui dans un monde impitoyable pour les petits.
[…]
« « Oui, conclut la cigale au sourire charmant,
On dit qu’en cas de non-paiement
D’une ou l’autre des échéances,
C’est eux [les pauvres] dont on vend tout le plus facilement. »
Maître Renard qui se croyait cynique
S’inclina. Mais depuis, il apprend la musique. »
Jean-Pierre Siméon, l’animateur passionné du Printemps de Poètes, était aussi présent avec deux textes. Le premier, dit par Silvio Pacitto, « La secrète nuance de la vie », nous a proposé une définition de la poésie, celle qui « veut tenir la mer dans ses mains » et pour laquelle « comprendre, c’est étreindre ». Les poètes ne sont-ils pas indispensables ? « On aura toujours besoin d’idiots dans le village… »
L’autre texte, empreint d’un humour ravageur, et modulé par Jean Lespert, a stigmatisé les méfaits du jeunisme qui contraint chacun à « jouer le jeu du jeune jusqu’à ce que la peau lui tombe », tout en exaltant les beautés du « vieuxisme » :
« J’aime la beauté demeurée autre dans les rides […] J’aime la grande patience de ceux-là très proches d’être morts ».
Les grands classiques n’avaient pas été non plus oubliés. Michel Miramont nous a ainsi bercés avec le pentamètre de Louis Aragon, dans « Au bout de mon âge ». Merveilleux quatrains tout en légèreté, qui disent l’éphémère du destin d’un homme, ce « chant égaré » en équilibre entre hasard et poésie :
« […]
Tant pour le plaisir
Que la poésie
Je croyais choisir
Et j’étais choisi !
Je me croyais libre
Sur un fil d’acier
Quand tout l’équilibre
Vient du balancier
Au bout de mon âge
Qu’aurais-je trouvé
Vivre est un village
Où j’ai mal rêvé. »
Michel Miramont nous a rendu un instant l’enfance avec « Jeanne était au pain sec », extrait de L’Art d’être grand-père de Victor Hugo. Qui n’a pas en mémoire la chute du poème, avec la réplique de la petite-fille à son grand-père trop indulgent :
« Eh bien, moi, je t’irai porter des confitures ! »
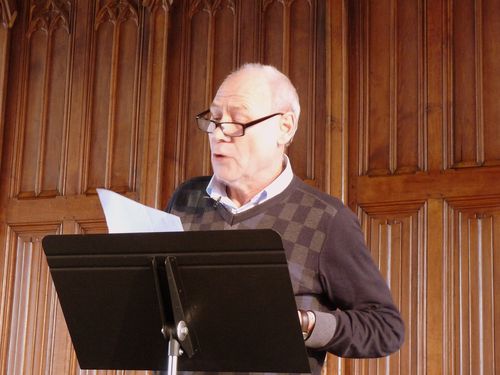
Jean Lespert
Et Jean Lespert nous a remémoré les aspirations contradictoires de l’homme avec les quatre quatrains de « L’homme et la mer » de Baudelaire. Si la mer est son propre miroir, si elle révèle son aspiration à l’infini, elle est aussi appel au néant et à la mort.
« Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir, tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. […] »
Mais ce petit intermède poétique a surtout été pour moi l’occasion de découvrir un poète dont j’ignorais tout, Jehan Jonas, dont Jean Lespert a lu un texte. Celui-ci, tout rempli d’ironie tragique et d’humour noir, est le monologue d’un homme qui a tué sa femme et qui ne comprend pas pourquoi on l’arrête :
« Je l’ai tuée, je l’ai tuée […] Tout de suite, les grands mots ! », dit-il sans sourciller. « La vie, c’est sacré, surtout quand on l’a plus […] » reconnaît-il. Il se trouve même des circonstance atténuantes : « C’était une emmerdeuse, pas une imbécile », allant jusqu’à se faire plaindre : « Je suis veuf, maintenant, qu’est-ce que je vais devenir ? »
Jehan Jonas est passé comme un météore dans le ciel de la poésie. Né à Paris en 1944, il est mort en 1980, à 35 ans, d’une maladie qui l’a emporté en un mois. Cet ancien électricien- ajusteur de formation écrit ses premiers textes dès 1961 et il composera plus de 250 chansons, dont « Comme dirait Zazie ». Il chantera aux terrasses de Saint-Germain-des-Prés, à la Contrescarpe, au Don Camillo, produira plusieurs 33 tours, créera deux spectacles, fera des récitals à travers l’Europe et participera à des émissions de télévision. Autodidacte doué, il laisse une œuvre multiple, pleine de gouaille, de cynisme, de révolte et de poésie.
Merci donc à ces trois passeurs en poésie, dont les textes choisis feront peut-être l’objet d’un prochain spectacle. Grâce à leurs trois voix libres, cette journée du vendredi 22 mars nous aura semblé printanière.
Voir le site consacré à Jehan Jonas : link

















/http%3A%2F%2Fwww.budapesttimes.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2F28.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.xpatloop.com%2Fcontrols%2Fthimage.aspx%3Fimg%3D%2F15%2F737b2089-f47e-4243-9dd4-11303bb2a911.jpg%26d%3Da%26w%3D600)
















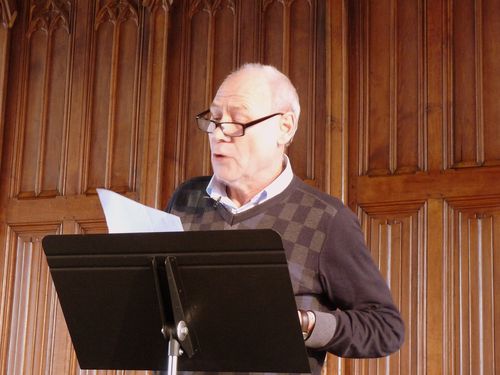


/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)
