
La Décollation de Jean le Baptiste, Le Caravage, co-cathédrale Saint-Jean à La Valette, à Malte
Du lundi 20 au dimanche 26 avril 2015, j’étais à Malte avec ma fille. L’occasion pour moi de faire plus ample connaissance avec Michelangelo Merisi, dit Le Caravage (1573-1610), qui laissa une empreinte profonde dans cette île où le baroque est en majesté. L'artiste y est présent dans la co-cathédrale Saint-Jean et au musée des Beaux-Arts. A la faveur de ce voyage, j’ai lu les pages magistrales que Dominique Fernandez a consacrées au peintre dans sa superbe autobiographie romancée de l’artiste, La Course à l’abîme, et particulièrement l’analyse qu’il a faite de la toile, La Décollation de saint Jean le Baptiste (1608). Ses lignes illustreront mon billet.
Dans l’extraordinaire co-cathédrale Saint-Jean de La Valette où, sous le marbre rouge, blanc, noir, décoré de squelettes, reposent quatre cents chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, nous avons pu admirer ce célèbre tableau. Cette toile, d'une beauté sombre, est exposée dans l’Oratoire, lieu de dévotion privé, pour lequel elle fut peinte, en face d’un autre tableau, Saint Jérôme écrivant, chef d’œuvre à part entière lui aussi.
Cette dernière œuvre avait particulièrement plu au Grand Maître de l’Ordre de Saint-Jean, le Français Alof de Wignacourt, et c’est pourquoi celui-ci avait alors passé commande de cette imposante Décollation de saint Jean le Baptiste (5,20x3,61). Les armes de la famille de Wignacourt sont d’ailleurs visibles sur la toile. Dominique Fernandez fait ainsi parler Le Caravage : « La Confrérie de la Miséricorde me commanda un tableau pour la cathédrale Saint-Jean. Jean le Baptiste est l’objet d’une vénération particulière auprès des chevaliers de Malte : ils ne s’appelaient, au début de leur histoire, que les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem […] De dimensions exceptionnelles (près de dix-sept pieds de largeur sur plus de onze de hauteur !), la toile couvrirait le mur du fond. Je devais représenter la mort du Baptiste. J’étais libre de traiter le sujet à ma guise, sous une seule réserve : montrer qu’il n’avait pas été décapité du premier coup d’épée, mais qu’il avait fallu l’achever au moyen d’un couteau. »
Le tableau fascine à de nombreux égards. Il en émane une impression très forte de désolation, créée par la sombre profondeur de la scène de décapitation qui se joue dans une prison, aux murs d’un brun verdâtre, que creuse une porte ronde, flanquée d’une barrière, cernée de gros moellons noirâtres. Selon le traité de Federico Borromeo, De pictura sacra, quand on représente la mort du Baptiste, il faut la situer « dans l’horrible et sinistre prison où il a été enfermé avant son supplice ». Fernandez explique en ces termes le choix du décor par le peintre, mécontent de l’avarice du Grand Maître : « Tout en feignant de peindre une cour sombre et nue, je mis la scène sur le seuil de son palais. On reconnaît, dans la pénombre, l’arc cintré et le bossage du portail et, à côté du portail, une des fenêtres grillagées de la façade. Pour donner le change, j’ai fixé un gros anneau de fer dans le mur sous la fenêtre, et fait pendre de la corniche une longue corde. Anneau et corde : accessoires obligés d’une prison qui se respecte, ils indiquent l’endroit où Jean a été attaché. »
Au premier plan, saint Jean-Baptiste, dont le bas du torse est recouvert d’un drap rouge sang, est étendu sur le sol, les mains liées derrière le dos, tandis que le bourreau à la barbe noire, au corps musculeux et blafard, s’apprête à lui trancher la tête qu’il maintient violemment de sa main gauche ; la droite, cachée derrière son dos, tient la dague assassine. Il s’agit d’un certain type de couteau, appelé « miséricorde », et dont le bourreau se sert pour porter le coup de grâce. L’horrible office a en effet déjà été entamé puisqu’on aperçoit à terre la pointe d’un glaive et que du sang jaillit du cou du martyr.
Dominique Fernandez décrypte le martyre du saint dans une perspective très particulière, véritablement sado-masochiste, et fait dire au Caravage : « Au centre de la toile, sous la lumière qui les frappe en plein, je me suis joué, une fois de plus, la scène d’amour entre le bourreau et la victime. » L’écrivain imagine aussi les pensées du Baptiste : « […] Bourreau, j’attends, de ta miséricorde, le coup de grâce qui va me délivrer. Mais nous savons tous les deux, n’est-ce pas ? qu’il ne faut pas entendre ces mots de miséricorde et de coup de grâce dans le sens que leur donnent les pieux docteurs de l’Eglise. J’aime ta force et ta violence, comme tu aimes ma docilité et ma soumission. »
Selon Fernandez, c’est là que réside l’audace insensée d’un peintre, à la pensée tout hérétique, et qui s’identifie lui-même à saint Jean-Baptiste : « Nulle tragédie sacrée, ici : un simple homicide, comme il en arrive dans les bas-fonds d’une ville au cours des heures nocturnes où ne restent à rôder dans les rues que ceux qui ont un compte à régler avec le destin. Fais-moi la grâce, bourreau, de me donner cette mort abjecte à laquelle aspire mon âme depuis qu’elle a découvert où se tient le vrai Dieu. »
A cet assassinat fantasmé du peintre, qui sera sans doute quelques années plus tard le sien sur une plage italienne, Fernandez superpose encore un autre meurtre, celui du père de l’artiste, « mort poignardé par des tueurs dans une rue de Milan ». Une manière pour l’artiste de réparer cette fin infâme. L’on sait aussi que dans la toile, David avec la tête de Goliath (1605-1606), dont Le Caravage ne se sépara jamais, il a fait son autoportrait avec la tête du décapité.
En 1982, dans le roman Dans la main de l'ange, qui racontait la vie de Pier Paolo Pasolini, Dominique Fernandez avait plusieurs fois évoqué Le Caravage. Il y avait déjà suggéré de "regarder l'oeuvre peint du Caravage comme une chronique codée de sa vie". Etablissant des liens par-delà les siècles entre le peintre et Pasolini, il avait ainsi imaginé un Pier Paolo fasciné par le tableau du Martyre de saint Matthieu et le commentant en ces termes : "Cette stupeur médusée de l'apôtre devant la jeunesse et la splendeur de son bourreau me laissait tout rêveur ; et bien qu'une docilité aussi passive me parût condamnable, je me disais qu'il faudrait une force surhumaine pour ne pas souhaiter mourir foudroyé par une telle apparition."

David avec la tête de Goliath
A gauche de la toile, on voit une femme qui présente un plateau de cuivre sur lequel le geôlier, de l’index impérieux de sa main droite, ordonne de poser la tête du saint. Le Caravage aurait fait croire à Alof de Wignacourt qu’il s’agissait de Salomé. Or, selon Fernandez, outre le fait qu’« un crime dû au caprice d’une femme ne [l] eût pas inspiré », la volonté du peintre n’aurait été, « sous le couvert d’un épisode emprunté à la Bible », que de peindre seulement un sordide fait divers. Cette jeune femme, dont la mise est une simple robe noire qu'éclaire un linge blanc noué à la taille, ne serait donc qu’une servante de la prison.
Une vieille femme, en robe brune et coiffée d'un béguin blanc (souvenir peut-être des servantes du Souper à Emmaüs), dans une expression d’horreur, se prend la tête dans les mains. Deux prisonniers, dont l’un a la tête ceinte d’un bandeau blanc, assistent avec curiosité et voyeurisme à l’exécution, penchés derrière les barreaux d’une fenêtre.
Quant au geôlier (les clefs qu’il porte à la taille confirment cette fonction), l’interprétation de Fernandez est qu’il ressemble à Alof de Wignacourt dans son portrait en pied (1608). Il aurait la même pose : « corps appuyé sur la jambe gauche, jambe droite infléchie. La même barbe, le même front dégarni, une même affectation de noblesse et de majesté complètent la ressemblance. Il n’y a pas jusqu’au geste du bras qui ne soit identique. » Mais au lieu de tendre la main droite vers le sol, le Grand Maître tient son bâton de commandement à l’horizontale. Audace encore du peintre vis-à vis de celui qui tient son sort entre ses mains ! Et que dire encore du fait que le Grand maître et son jeune page soient disposés sur le même plan, sans aucun respect de leur rang ?

Portrait d'Alof de Wignacourt
Avec ironie, Dominique Fernandez imagine les visites régulières du Grand Maître lors de l’élaboration du tableau et la crainte du Caravage qu’il ne s’offusque d’être représenté en geôlier et en « complice du plus abominable des assassinats ». Or, sa vanité l’induit en erreur puisque, dans le personnage portant des clés à la taille, il croit que le peintre l’a représenté en saint Pierre, qui ouvre les portes du paradis au Baptiste !
C’est le plus grand tableau que l’artiste rebelle ait jamais réalisé et le seul connu à ce jour qu’il ait signé : la signature est en effet visible dans le sang qui sourd du cou de saint Jean. Son nom est précédé de la lettre F pour Frate, ce qui indique que, durant le temps de la réalisation de l’œuvre, Le Caravage avait bien été promu chevalier de Grâce de l’Ordre de Saint-Jean. Il avait en effet souhaité devenir chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, persuadé que cela faciliterait son pardon par le pape Paul V après le meurtre à Rome de Tommasoni, forfait qui l’avait contraint à quitter la Ville éternelle.
Pietro Ambrogiani écrira : « On ne peut s’empêcher de penser que l’artiste s’est inspiré de son expérience personnelle. » Et l’imagination de Dominique Fernandez propose en effet une autre hypothèse. Souhaitant secrètement dédier cette toile à son père assassiné, Le Caravage l’aurait signée, en geste d’amour filial, de son unique prénom, Michelangelo, celui qu’il avait « reçu de [s]on père, quand il [l]’avait tenu sur les fonts baptismaux ». Il aurait donc choisi d’écrire sa signature dans le sang : « Le sang : seul sujet de mon tableau, le sang qui serait aussi l’encre dans laquelle j’écrirais mon nom. » Pour le peintre, signer dans le sang du Baptiste aurait encore signifié qu’il s’identifiait « complètement à la victime » : « Me voici, à la première personne, mais la tête détachée du corps. Le moi que j’affiche est un moi décapité. Ne m’accusez pas de vanité : ce peintre qui attire sur lui l’attention n’est déjà plus de ce monde. » Et devant Michelangelo, il aurait ajouté ce F., le F. de feu, « il fut », « le sceau de la mort sur le prénom que m’avait donné mon père ». Il y aurait ainsi volonté d'identification totale entre le peintre et le Baptiste.
Fernandez explique que les réactions devant cette signature furent diverses : « On dirait que c’est vous qui avez commis le crime », dira avec horreur Alessandro, le page du Grand Maître. Ce dernier, en revanche, ne vit dans ce F. que l’abréviation de Frate, et l’expression d’une solidarité forte avec les Frères de l’Ordre. Il vit aussi en ce tableau une réminiscence de la décapitation de cinq chevaliers de l’Ordre, lors du Grand Siège de 1565 par Mustapha Pacha. « Ton tableau, dit-il à l’artiste, a conquis le droit de devenir l’emblème des chevaliers de Malte, […] L’horreur, mais aussi la gloire de la décollation apparaissent aujourd’hui si intimement liées à notre histoire, que ton tableau résume à la fois la chronique et la mystique de notre Ordre. » Une interprétation certes bien éloignée des préoccupations et des desseins picturaux du Caravage !
Alof de Wignacourt souhaita ensuite que l’artiste réalisât son portrait (1608). Cependant le peintre succomba de nouveau à ses anciennes obsessions homosexuelles. Aux côtés du Grand Maître, pétrifié dans son armure antique, il représenta le jeune page Alessandro, qui porte son heaume. Dans le monde viril des chevaliers chastes et célibataires, cet adolescent à l’éclat provocateur fit scandale et éclipsa la célébrité du Grand Maître. A la même époque, il semble que le peintre ait réalisé un Cupidon endormi (1608), réminiscence de l’enfant nu de La Madone des Palefreniers ou Madone au serpent (1605-1606), quoique moins impudique. Cette œuvre était bien évidemment en contradiction absolue avec l’esprit des Hospitaliers et ne pouvait que porter tort au nouveau chevalier de Saint-Jean..
La Caravage fut donc arrêté et consigné dans la prison de Sant’Angelo. On n’a cependant retrouvé aucun acte d’accusation dans les archives de l’Ordre. Les hypothèses sont nombreuses quant aux raisons de son arrestation. L’artiste aurait-il tenté de séduire le fils d’un magistrat ou d’un ministre de l’Ordre ? La sentence papale aurait-elle soudain été révélée à l’Ordre qui aurait été horrifié de la découvrir alors ? Le Caravage aurait-il été victime d’un complot fomenté par les Hospitaliers, scandalisés par son Cupidon endormi ? C’est pour toutes ces raisons sans doute qu’il fut exclu de l’Ordre. Le document juridique qui le désigne comme putridum et foetidum a été découvert il y a quelques années. De nouveau contraint à fuir, le peintre s’évada périlleusement du fort Sant’Angelo et s’embarqua pour la Sicile. Un an après encore moult bagarres et pérégrinations, cet artiste hors-norme mourra à 38 ans dans des conditions mystérieuses à Porto Ercole, en Toscane, peut-être comme Pier Paolo Pasolini, victime d’un meurtre.
La renommée de La Décollation de Jean le Baptiste fut instantanée. Dans les années qui suivirent, nombreux furent les peintres du Nord qui souhaitèrent entreprendre le voyage à La Vallette pour admirer la toile. Ce tableau d’une grande puissance picturale se caractérise donc par son réalisme vigoureux et une maîtrise parfaite du chiaroscuro, le clair-obscur, dont Le Caravage fut un des premiers initiateurs. Opposé au maniérisme, l’artiste rebelle, dont la priorité est le naturel et la vérité, propose un nouveau langage de réalisme théâtral, qui prend ses modèles dans la rue. Pour chaque sujet, et même, comme on l’a vu, pour les thèmes les plus sacrés, il choisit l’instant le plus dramatique. Il est l’expression la plus remarquable du baroque, cette période de fureur et d’excès, qu’il investit totalement et dont il exacerbe l’orageuse atmosphère. Scandaleux toujours, il est celui dont Nicolas Poussin fit à Rome l’éloge funèbre en ces termes : « Il est venu détruire la peinture. »
Selon le grand critique italien, Roberto Longhi, qui, vers 1920 sortit Le Caravage d’un purgatoire de 300 ans, « le maître de l’ombre et de la lumière » a profondément influencé le XVII° siècle et notamment Rembrandt, Ribera, Vermeer et La Tour « qui n’auraient pas existé sans lui ». Après eux, Delacroix, Géricault, Courbet, Manet lui sont aussi redevables. A l’exception peut-être de Michel-Ange, aucun autre peintre italien n’a exercé une telle influence. Bernard Berenson le reconnaît : « Après lui, la peinture ne pouvait être la même. » Et André Berne-Joffroy, secrétaire de Valéry, de le confirmer : « Après lui, c’est tout simplement la peinture moderne ! »
En lisant ces lignes, on comprendra que La Décollation de saint Jean le Baptiste m'a laissé un souvenir marquant. J'ai vraiment trouvé fascinante cette idée qu'un peintre puisse ainsi s'identifier à son modèle, selon le décryptage inspiré de Dominique Fernandez.
Sources :
La Course à l'abîme, Dominique Fernandez, 2002, LP 30317
Dans la main de l'ange, Dominique Fernandez, Grasset, 1982
Caravaggio, Gilles Lambert, Taschen, 2004
/image%2F1488802%2F20201222%2Fob_b94104_20201222-151426.jpg)
/image%2F1488802%2F20201223%2Fob_afa928_20201222-153050.jpg)
/image%2F1488802%2F20201222%2Fob_6d88d8_20201222-153108.jpg)
/image%2F1488802%2F20201222%2Fob_f9c43c_20201222-153127.jpg)
/image%2F1488802%2F20201222%2Fob_f5c078_20201222-153229.jpg)
/image%2F1488802%2F20201222%2Fob_9df104_20201222-153251.jpg)
/image%2F1488802%2F20201222%2Fob_d1fc1e_20201222-153310.jpg)
/image%2F1488802%2F20201222%2Fob_1b4b94_20201222-153329.jpg)
/image%2F1488802%2F20201222%2Fob_888e14_20201222-153144.jpg)
/image%2F1488802%2F20201222%2Fob_3d0bbc_20201222-153209.jpg)


/image%2F1488802%2F20201027%2Fob_4923df_20201011-144722.jpg)
/image%2F1488802%2F20201027%2Fob_823ca3_peupliers-au-bord-de-l-epte-effet-du-s.jpg)
/image%2F1488802%2F20201028%2Fob_2c99a1_20201022-104427.jpg)
/image%2F1488802%2F20201027%2Fob_596dd9_20201022-104719.jpg)
/image%2F1488802%2F20201027%2Fob_f31eb1_claude-monet-saules-au-bord-de-lyerres.jpg)
/image%2F1488802%2F20201027%2Fob_3f9b9d_monet-teich-im-park-montgeron.jpg)
/image%2F1488802%2F20201028%2Fob_50aa43_20201022-104533.jpg)
/image%2F1488802%2F20201027%2Fob_e488ba_whatsapp-image-2020-10-23-at-21-50-12.jpeg)



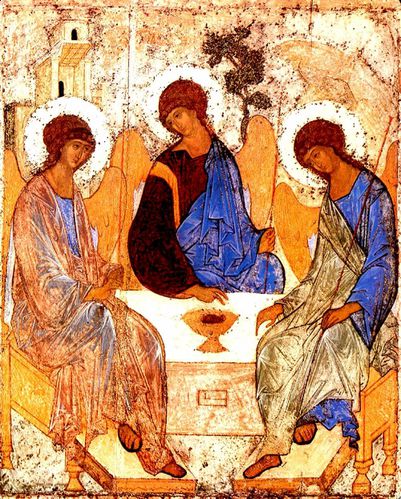



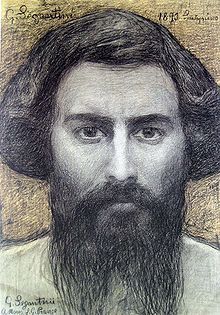




/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)
