
Autour de notre Jean d’Ormesson national, pour Saveur du temps, hier soir, jeudi 1er octobre, à l'émission La Grande Librairie, François Busnel recevait Pascal Jardin (Quinze ans après), Dany Laferrière (L’Enigme du retour) et Sarah Kaminsky (Adolfo Kaminsky, Une vie de faussaire). Une émission sous le signe des affabulateurs, des faussaires, des imposteurs : des écrivains en somme…
Après avoir lancé en manière de prologue une de ses citations percutantes dont il a le secret (« La littérature, c’est l’art de domestiquer le chagrin par la grammaire »), et dont il dit que s’abriter derrière elles est pour lui une forme de modestie, Jean d’O., comme on l’appelle familièrement, se reconnaît dans cette définition de l’écrivain faussaire. Il déclare en être peut-être un car il existe dans l’écriture une part de comédie qu’il faut s’efforcer de réduire. Si l’imposture est facile dans la vie, elle est plus difficile dans l’écriture et la Télévision lui apparaît comme une bonne machine à débusquer l’imposture.
En même temps que la réédition de L’Enfant qui prenait le train, récit pour les enfants, paraissent ses Chroniques, Saveur du temps (1948-2009), dans le droit fil de Jean qui grogne et Jean qui rit, chroniques politiques écrites il y a quarante ans, et de Odeur du temps, ouvrage paru il y a trois ans. Après le rappel que Jean d’O. rime avec Figaro, quotidien dont il fut exclu à cause d’un article sur le directeur d’alors Pierre Brisson, et qu’il réintégra (pour en devenir le directeur de transition, en phase avec l’opinion, en 1974 jusqu’en 1977), après l’élection à l’Académie française en 1973, on comprend que ce qui essentiel pour ce « fascinant pédagogue » comme le qualifie Philippe Labro, c’est encore et toujours la littérature. A Busnel qui lui demande à propos de l’Académie française pourquoi vouloir devenir quelque chose quand on est quelqu’un, il répond par une boutade : « Pour faire plaisir à ma mère, pour rencontrer des gens charmants, pour céder à une tentation… )
Ces textes, écrits entre 1948 et 2009, sont des exercices d’admiration sur la littérature et des articles politiques. D’Ormesson s’y montre donc aussi journaliste, selon la définition de Camus pour qui « le journaliste est l’historien de l’instant. » Gide, quant à lui, était sévère pour les journalistes, lui qui écrivait : « J’appelle journalisme ce qui sera moins intéressant demain qu’aujourd’hui. »
L’académicien, toujours un peu cabot, s’amuse à rire de son âge : « J’ai toujours été un jeune con. J’ai fait des progrès ; maintenant, je suis un vieux con. » Et de rajouter : « J’ai compris que j’étais vieux quand on m’a dit : « Comme vous êtes jeune ! » C’est pourquoi il s’efforce de ne pas trop ressasser le passé.
A François Busnel qui rappelle son parcours et lui demande quel jeune homme il fut, il répond qu’au début il n’a jamais pensé à devenir écrivain. A dix-huit ans, il envoie un article au Monde, qui n’était « pas très bon », mais qui lui permet maintenant de comprendre qu’il a fait des progrès ! Son premier ouvrage, La Gloire de l’empire, paraît alors qu’il a trente-cinq ans et suscite les ricanements de ses camarades de l’Ecole Normale, pour lesquels un Normalien qui se respecte n’écrit pas de roman. Longtemps, il a hésité à écrire, ayant une très haute idée de la littérature : « Il me semble que je suis trop souvent- et je le déplore- au bord du ridicule. » Quand il écrivait, il avait sous les yeux Le Soleil se lève aussi d’Hemingway et Le Paysan de Paris d’Aragon : « Je n’y arriverai jamais » pensait-il, en voyant les oeuvres de ces grands ancien. Si l’on n’est pas Péguy ni Aragon, ce n’est pas la peine d’écrire.
Il affirme par ailleurs être un écrivain du bonheur, ce qui lui a permis d’occuper un créneau vide. Bernard Frank, le critique du Nouvel Observateur ne lui disait-il pas : « Tu n’as pas assez souffert, tu ne seras jamais un bon écrivain » ? Et François Nourrissier son ami, à qui il rend pudiquement hommage dans l’épreuve de la terrible maladie dont il souffre, se situait aussi dans cette perspective d’une littérature du malheur. On écrit quand il y a quelque chose qui ne va pas. D’Ormesson rappelle alors l’engouement suscité par l’ancien bagnard Papillon qui avait vendu 500.000 exemplaires de ses mémoires et dont même Jean-François Revel avait fait la préface !
Celui que son frère appelait Moustique reconnaît se situer souvent dans la position de celui qui attaque mais avoir cependant un penchant pour l’admiration aux dépens du ricanement. Il affirme aimer l’avenir, en attendre beaucoup, et regrette de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Il aurait été très malheureux s’il était mort en 1943, car il n’aurait rien su de ce qu’il a vécu.
Ses derniers romans cependant sont davantage marqués par la mort, bien qu’il ait été en réalité très tôt habité par cette idée. C’est pour cela qu’il a aimé Heidegger et son « Etre pour la mort » ("Sein-zum-Tode"). « Un jour, il faudra quitter la table, ne plus écrire ou comme Norman Mailer, mourir en écrivant. » Mais il faut lutter contre ce sentiment et être gai : « En vérité, je suis un mélancolique béni des dieux ! »
A l’instar de Mauriac, ses chronique sont, selon François Busnel, peut-être la partie la plus importante de son œuvre. Mais comme le précise d’Ormesson, on ne sait pas ce qu’on écrit. Voltaire, qui accordait du prix à son Siècle de Louis XIV, ouvrage « sérieux », aurait été stupéfait de savoir qu’il resterait dans la littérature avec ce qu’il appelait ses « couillonnades », Candide et Zadig.
Ensuite, François Busnel se demande si le dernier livre d’Alexandre Jardin ne brosse pas le portrait d’un homme qui a changé. Avec cet ouvrage, intitulé Quinze ans après (le roman de Fanfan), qu’il qualifie de « jardinissime », l’auteur n’a-t-il pas fait un pas de côté? Si le petit-fils de Jean Jardin et le fils de Pascal Jardin, le créateur de l’association Lire et Faire Lire (des retraités lisent des livres aux enfants), le réalisateur de trois films dont Fanfan (avec Vincent Perez et Sophie Marceau), est toujours aussi corrosif, n’est-il pas devenu le « Lancelot du Lac de la pantoufle » ? Dans Quinze ans après, Acte II, Alexandre Jardin laisse entendre que l’usure des sentiments dans le couple qu’il craignait n’existe pas. Il s’y fait le chantre d’un érotisme domestique, d’un érotisme ménager auquel il a converti Fanfan. Comment faire pour que le couple soit tout, sauf la ménopause de l’amour ? Tel est le problème posé par cette farce burlesque. Il faut donc pratiquer le fétichisme de la pantoufle, introduire du suspense dans le quotidien, changer le langage, jouer avec les mots, créer la féérie. "La passion ne souffre pas de la vie de couple mais de l’idée trop sage que l’on en a." Il faut donc en faire un 8° art.
Le livre est un mélange de réalité et de fantaisie, où le « zèbre » est devenu une descente de lit sur laquelle on fait l’amour, mais où les milieux de l’édition ne sont pas épargnés. « Nous sommes tous des proxénètes », déclare un éditeur discutant avec un critique de cinéma. Et à ceux-là Jardin préfèrent les éditeurs qui gardent « leur esprit de pirate », telle Françoise Verny, son premier éditeur. Jean d’Ormesson y est même mis en scène : ayant rencontré une femme qui lui plaît, il la suit dans sa chambre qui est obscure. Croyant l’embrasser, il se rend compte qu’il est en train d’embrasser le vieux Monsieur Jardin ! On y voit aussi le successeur de Jean d’Ormesson à l’Académie française (ce « cimetière de prostates » !) prononcer l’éloge funèbre de son prédécesseur. Et Jean d’Ormesson de commenter : « Nous sommes tous des morts qui n’ont pas encore pris leurs fonctions. »
Quand on dit à Alexandre Jardin : « J’attends de toi que tu écrives un livre où tu perdes pied », il répond qu’il est peut-être encore trop jeune et que c’est une tâche très difficile. D’Ormesson admet qu’il en a sans doute écrit un ou deux. Un bon livre change le lecteur et celui qui l’a écrit, il leur fait perdre pied.
Dany Laferrière, écrivain québécois- haïtien- floridien, mais aussi, dit-il, « écrivain japonais » (titre d’un de ses romans), né en 1953, est invité pour L’Enigme du retour, qui raconte son retour en Haïti, son pays natal quitté à l’âge de vingt-trois ans, et dans lequel il mêle prose et poésie (des haïkus ou haikai!). Celui qui déclare avec humour : « Je suis le nègre d’un imposteur » est un écrivain, cinéaste et libre-penseur, qui a connu la célébrité avec son roman Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer. Vivant depuis trente ans au Canada, il attend la mort de son père pour revenir au pays. « Ca commençait bien ! »
Il évoque Montréal et son hiver de six mois : « Mon pays, c’est l’hiver », chante Gilles Vigneault et le vers célèbre d’un grand poète canadien : « Ah ! Comme la neige a neigé ! » Il reconnaît qu’un écrivain est fait des fantômes de tous les écrivains. Ses maîtres sont Borgès, et James Baldwin, celui qui « a su opposer au monde le matin calme au lieu du crépuscule sanglant ». Quand Busnel demande à Laferrière s’il aime Césaire, il avoue qu’au début il l’a trouvé bien fade, trop oratoire, mais que, ensuite, il a compris qu’il n’était pas que le chantre de l’anti-colonialisme. Césaire est celui qui s’est frayé un chemin dans la forêt du langage pour voler l’alphabet. Et Laferrière a aimé le sourire de Césaire qui ressemblait à celui de son père.
Son livre « parle au cœur des hommes en direct du monde » (site Etonnants Voyageurs), dans un Haïti en proie à la chaleur et à la misère mais la joie y est très présente. C’est le peintre primitif haïtien qui l’influence, celui à qui on demande : « Pourquoi peignez-vous une nature luxuriante dans un monde de désolation ? » et qui répond : « Mettrait-on dans son salon ce qu’on peut voir par la fenêtre ? » Dans un tableau classique, le point de fuite est situé dans le fond du tableau ; chez le peintre primitif, le point de fuite est dans le plexus de celui qui regarde. Dany Laferrière veut intoxiquer le lecteur par les sons, l’ambiance. Il veut qu’il oublie de penser, qu’il perde pied, comme il a été dit plus haut.
Il explique la forme insolite de son roman (prose et poésie) par le fait que la tenue d’un carnet de notes lui a permis de "mitrailler la réalité" et d’être au plus près du présent. Il fait ainsi naître des émotions nouvelles pour mieux faire voir le passé.
Il termine son intervention en disant qu’il voulait être un écrivain rock et qu’on écrit avec l’idée qu’on se fait d’un écrivain. Comme Hemingway, il aime avoir bière et vin à côté de sa Remington. Celle-ci permet une distance créée par la main. Il a alors l’impression qu’il écrit sous la dictée.
François Busnel, pour terminer, donne la parole à Sarah Kaminsky qui, avec Adofo Kaminsky, Une vie de faussaire, se fait la biographe de son père. Ecrivain, née d'une mère algérienne et d'un père russe d'origine argentine, elle a écrit très tôt des histoiresdéchirantes (c'est son père qui le dit), qui évoquent la douleur de son passé, des choses lourdes à porter Elle est aussi musicienne (elle joue du violoncelle), et une comédienne qui écrit des scénarii. Pour Jardin, son livre est jouissif et pour d’Ormesson, rien n’[y] est plausible et tout [y] est vrai. On dirait un livre de Jardin, rajoute-t-il.
On découvre dans cette œuvre un homme extraordinaire qui depuis toujours a fabriqué des faux-papiers : pour des enfants juifs, pour des Juifs voulant fuir l’Europe après la guerre, pour des hommes du FLN, pour des guérilleros, pour des résistants aux régimes dictatoriaux européens et même pour Cohn-Bendit. L’auteur explique que le livre, mi-confession, mi-enquête, est un long chemin, le résultat de longs entretiens avec son père, d’échanges et de dialogues qu’elle a suscités, car son père n’aurait jamais parlé de lui-même.
A Busnel qui admire qu’elle ait écrit le livre, véritable œuvre de littérature, à la 1° personne en se mettant dans la peau d’un vieux monsieur de quatre-vingt-quatre ans, elle explique que, si elle avait écrit au passé à la 3° personne, elle aurait eu l’impression d’enterrer déjà son père.
Sarah Kaminsky évoque une scène hallucinante qui eut lieu en 1944 où son père réalisa 800 faux-papiers en 48 heures, sans dormir ni manger. Car pour seule une personne, il fallait compter nombre de documents : passeport, carte d’identité, carte d’alimentation, certificat de baptême… Adolfo Kaminsky se sentait responsable de la vie des autres et tenu au secret. De plus, il ne demanda jamais d’argent pour ses services, ce qui lui permit de garder son entière liberté, de dire non quand il le voulait. Il respecta toujours ces règles pour ne pas être inquiété. En protégeant sa vie, il s’assurait ainsi qu’il pourrait continuer à sauver ceux qui en auraient besoin. Avec humilité, il dit qu’il n’est pas courageux alors que toute sa vie en est l’éclatant démenti!
Sarah Kaminsky considère qu’elle a eu un père comme les autres et son identité à elle n’en a pas été perturbée. Pour elle, son père n’était pas un faussaire, contrairement au personnage de Jardin. Elle croit fermement qu’on peut vivre dans la dimension romanesque, qu’on peut se faufiler dans le réel pour trouver le romanesque et que le réel n’est pas toujours plausible. Jardin et Busnel concluent que c’est un livre jubilatoire et splendide.
Le libraire de la Librairie parisienne Le Divan recommande le livre de Gilles Heuret, L’Homme de cinq heures. Histoire d’un homme qui est accosté par Paul Valéry (mort en 1945) et réflexion sur la célèbre phrase d’André Breton disant qu’on ne peut plus écrire : « Et la marquise sortit à cinq heures. » Un livre amusant qui permet une plongée dans l’histoire littéraire et conduit le lecteur à la rencontre de nombreux écrivains.
Jeudi 08octobre, un rendez-vous à ne pas manquer : François Busnel sera chez Philippe Roth.
Le 02 octobre 2009


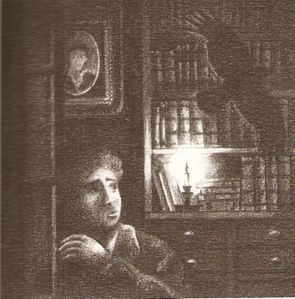
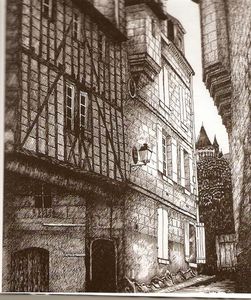


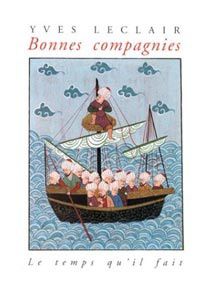





/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)
