
Vendredi 01 janvier, à 20h45, Arte diffusait la version télévisée de Lady Chatterley et l'homme des bois, réalisée par Pascale Ferran. Revoir ce film dans sa version longue n'a fait que conforter l'idée que la réalisatrice française a réussi avec cette oeuvre, justement récompensée par de nombreux prix, une adaptation intense et lyrique d'une oeuvre anglaise.
Pour les Anglais, en effet, Lady Chatterley de T. H. Lawrence, c’est un peu comme Madame Bovary pour les Français : un livre-culte de leur panthéon littéraire. Il fallait ainsi à Pascale Ferran beaucoup d’audace- et sans doute une très grande admiration pour ce roman- pour se lancer dans l’adaptation de cette œuvre, par ailleurs réputée sulfureuse.

On sait que David Herbert Lawrence écrivit trois fois son dernier livre. Le public a lu surtout la dernière version, celle que l’auteur considérait comme définitive, qu’il fit éditer à compte d’auteur en mars 1928, et dans laquelle la question de la révolution industrielle est très présente. Le garde-chasse (du nom d’Olivier Mellors) devient une sorte d’intellectuel qui tient un vrai discours politique, se faisant ainsi en quelque sorte le porte-parole de Lawrence. Par ailleurs la fin en est plus optimiste, laissant présager que les amants pourront sans doute se retrouver.
La réalisatrice a préféré la deuxième version, moins bavarde selon elle, et orientée sur ce qu’elle appelle « le centre de feu de l’histoire, […] la naissance d’un couple, le processus d’amour et de transformation l’un par l’autre ». (Interview accordée à Audrey Jeamart).
Et si Lawrence a écrit trois fois cette histoire, la particularité du travail de Pascale Ferran, c’est qu’elle en a tourné quant à elle deux versions, Lady Chatterley, version courte pour le cinéma (2h48) et Lady Chatterley et l’homme des bois, version longue pour la télévision, en deux épisodes de 1h44 et 1h37. Bien qu’elle soit extrêmement fidèle au livre, ce choix lui a permis de s’approprier l’histoire comme elle le souhaitait. La double version lui donnait par ailleurs l’occasion d’obtenir double financement.
La version télévisuelle longue s’est d’abord imposée à Pascale Ferran car, pour elle, la durée logique de l’adaptation se situait entre trois et quatre heures. La version cinématographique devait se situer dans la perspective de cerner davantage l’évolution des personnages. Ayant vu en premier cette dernière version, je craignais une lassitude à voir la version longue. Or il n’en est rien, bien au contraire, les personnages se métamorphosant devant nous au rythme du défilement des saisons, particulièrement bien rendu.
Publié à Florence en 1928, Lady Chatterley’s Lover ne fut imprimé au Royaume-Uni qu’en 1960, l’ouvrage ayant suscité un énorme scandale dû, en partie aux scènes de relations sexuelles explicites, en partie au fait que les amants étaient un garde-chasse, classe subalterne, et une aristocrate. Le procès intenté aux éditeurs, Penguin Books, se conclut par un verdict d’acquittement, ouvrant ainsi la voie à une plus grande liberté d’expression.
N’existe-t-il pas en fait un grand malentendu ? En effet, c’est bien cet ouvrage, considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature érotique, que Lawrence avait envisagé d’intituler Tenderness (Tendresse). Il avait aussi indiqué qu’il n’avait pas écrit un « roman de sexe », précisant : « Je veux qu’hommes et femmes puissent penser les choses sexuelles pleinement, complètement, honnêtement et proprement. » Pascale Ferran l’a bien compris qui explique à sa manière : « Je pense que [Lawrence] cherche avant tout à raconter une intimité, qui se développe, entre autres, par des scènes d’amour physique entre les deux personnages. Cela fait complètement partie de leur trajet relationnel. Mais on n’est pas dans la pulsion animale. Il y a autre chose entre eux. C’est ce que je trouve très beau dans le livre. Le corps et l’âme des deux personnages ne font qu’un, tout le temps. »
La réussite de la version télévisée et du film tient justement à ce fragile équilibre entre la découverte des corps et la maturation spirituelle et morale de Constance Chatterley, la maîtresse de Wragby Hall, et de Parkin, le garde-chasse. La réalisatrice parvient à allier crudité et lyrisme et les six scènes d’amour initiatiques ne sont jamais vulgaires ni empreintes de voyeurisme. Entre les deux personnages que tout sépare s’instaure progressivement une intimité qui devient un véritable amour. A une gêne mêlée de respect, où les vêtements sont encore un rempart, à des dialogues rares où le tu se mêle au vous, va succéder un apprivoisement progressif, une découverte du corps de l’autre à la lumière, une volonté de toucher et d’être touché, une aspiration au baiser, un désir d’entendre de véritables paroles d’amour.
C’est ce cheminement, dont la gradation est remarquablement nuancée, qui fait la force du film et lui confère son émotion. Le dialogue final, notamment, dans lequel Parkin remercie Constance de l’avoir « ouvert » au monde, de lui avoir ôté toute peur, de l’avoir délivré de sa solitude, est particulièrement significatif à cet égard. Quant à Constance, si Parkin lui a fait découvrir l’union heureuse des corps et des cœurs, il lui aura aussi permis d’ouvrir son regard sur un univers d’injustice, symbolisé par Clifford Chatterley, qui ne peut concevoir que « ses » mineurs se mettent en grève.
Cette accession d’une femme à sa pleine féminité et à une réelle prise de conscience est rythmée par la vie de la nature, admirablement filmée. On pourrait trouver répétitif le rituel des promenades de Constance qui, en ouvrant quotidiennement la barrière de bois (ô combien symbolique), va de Wragby Hall à la cabane de Parkin, mais il n’en est rien. La nature y est montrée à l’unisson de ses humeurs et de ses sentiments : elle cueille des jonquilles quand le printemps arrive, son dos s’appuie à l’écorce des arbres à la recherche de sensations nouvelles, elle boit dans ses mains à la source courante quand l’amour lui est advenu, elle s’extasie avec candeur devant des oisillons nouvellement nés. Cet amour qui semblait voué à l’échec se fait panthéiste, symbolisé par la course joyeuse des amants nus sous la pluie, par leur union charnelle dans les feuilles et l’humus et par cette sorte de tableau pré-raphaélite où ils parsèment leur corps de fleurs et ceignent leur tête de couronnes de feuillages.
Si la relation entre Constance Chatterley et Parkin est bien évidemment au cœur du film, il serait cependant injuste de ne pas évoquer le personnage de Clifford Chatterley, subtilement interprété par Hippolyte Girardot. Revenu infirme de la Première Guerre mondiale, le maître de Wragby Hall est celui pour qui « aucun organe vital n’est atteint mais [pour qui] partout la vie est brisée ». Incapable de donner un héritier à son épouse, il lui laisse entendre au début que « tous les corps se valent » et qu’il ne verrait pas d’obstacle à ce qu’elle ait un enfant d’un autre homme, s’il est, bien évidemment, de son rang ! Sans être aucunement ce qu’on pourrait appeler un mari complaisant, il est donc celui qui permet à Constance de vivre le plus naturellement du monde la relation adultère, sans remords ni culpabilité.
Peu à peu, cependant, il la voit s’animer de nouveau après une grave période de neurasthénie et son orgueil reprend le dessus, surtout lorsqu’elle lui fait comprendre qu’elle pourrait être enceinte. Au cours d’une promenade avec sa femme, une scène burlesque le montre aux prises avec sa chaise roulante qui refuse obstinément de remonter la pente qu’il a descendue jusqu’à la source. Son amour-propre d’aristocrate lui interdit de demander l’aide de Constance et de Parkin. Il sera finalement contraint d’accepter leur secours, ne se doutant pas que, dans son dos, sa femme pose doucement sa main gantée de dentelle sur celle rugueuse et noueuse du garde-chasse. A la fin du film, lorsque Constance revient d’un voyage à Menton avec sa sœur Hilda, elle retrouve son époux, toujours fier et orgueilleux, qui a fait l’effort surhumain de quitter sa chaise roulante et de marcher avec des béquilles. On ne peut alors s'empêcher d'éprouver de la compassion pour cet homme brisé.
Clifford Chatterley est donc un personnage tout en nuances, qui oscille entre mépris et sollicitude, entre morgue et blessure intime, qui cherche à exister malgré son infirmité, en dirigeant sa mine, en s’adonnant au dessin technique et en lisant à voix haute Andromaque à Constance.
Ainsi, grâce au jeu de trois acteurs talentueux, et particulièrement celui d’une Marina Hands, naturellement lumineuse, et justement césarisée en 2007, ce film parfaitement maîtrisé réinvente le trio amoureux dans une Angleterre puritaine où les personnages ne sont jamais là où on les attend. Et comme l’écrit Yvette Reynaud-Kherlakian (www.e-litterature.net), Lady Chatterley et l’homme des bois constitue une « conquête hautement spirituelle [qui] se fait, non par volonté morale mais par une sorte de restauration spontanée et studieuse, grave et gourmande, de la dignité du sexe ».
Dimanche 03 janvier 2010

NB : A l'occasion de la rediffusion en deux épisodes de la version longue de Lady Chatterley et l'homme des bois (Jeudi 04 et 11 novembre 2010 sur Arte), je publie de nouveau l'article que j'avais écrit début 2010.








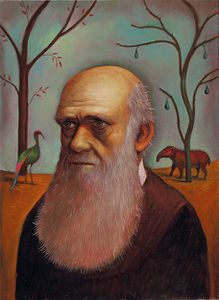





/http%3A%2F%2Fphotos.cityvox.com%2Fphotos_grand%2F27%2F57%2Fcatherine-hiegel,211227.jpg)
/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)
