
René de Obaldia, (Crédit Photo Lot)
Vendredi 06 mai 2011, sur la 5, la dernière émission de l’année de la série Empreintes était consacrée au dramaturge René de Obaldia. Agé de 92 ans, joué partout depuis plus de 50 ans, il semble tout étonné d’avoir atteint cet âge canonique. Ayant souvent utilisé ses textes déjantés et ludiques avec mes élèves, j’ai aimé ce film de Stéphane Haskell qui a brossé un portrait tout en finesse de cet éternel gamin rieur.
Il naît à Hong-Kong d’un père panaméen et d’une mère picarde. Puis la famille est abandonnée par ce père alors consul et elle se retrouve à Paris. René de Obaldia fait ses études au lycée Condorcet et sera mobilisé en 1940. Après la guerre, il commence à écrire des poèmes. Devenu parolier et figurant, il dit lui-même qu’il est entré dans le monde du théâtre un peu par accident.
Très vite, il éprouvera ce sentiment tragique de la vie. Devant une photo d’un film où il joua avec Louis Jouvet, ne fait-il pas remarquer que le grand acteur mourut six mois après ? Et devant la photo d’Hélène Carrère d’Encausse et de lui-même dans la bibliothèque de l’Institut, il s’amuse : « On dirait deux amoureux ! » Evoquant Dieu, il reconnaît qu’on ne prie pas assez. Et il ajoute : « Je prie d’être encore en vie, de marcher. Je prie Dieu, mais je ne sais pas lequel ! » Il rappelle qu’il avait écrit deux impromptus pour le Centre Interculturel de Royaumont, Le sacrifice du gourou et Le défunt. Il rit encore d’y avoir joué le rôle d’une veuve.
René de Obaldia a toujours refusé l’appellation d’avant-garde pour son théâtre : « On peut vite être d’arrière-garde, il suffit que je me retourne », ironise-t-il. Toujours est-il que c’est Jean Vilar qui montera sa première pièce, Genousie, dans laquelle il met à mal les règles dites classiques. Avec Ionesco, Beckett, Brecht, il deviendra un des tenants du théâtre dit de l’absurde. C’est véritablement en 1965 qu’il rencontrera la reconnaissance du public avec Du vent dans les branches de sassafras, et une renommée mondiale puisque son oeuvre est traduite en 28 langues.
Alors qu’il connaît une crise dépressive profonde, et que son courrier s’amoncelle, il se décide à ouvrir une lettre. Il y découvre un article d’un journaliste de Sud-Ouest sur le rire en liberté. « Pour ceux qui sont en dépression, » y lit-il, « une seule adresse, Obaldia ! »
Dans un dialogue avec lui-même, le film nous le montre en train de lire son célèbre vers, « Le geai gélatineux geignait dans le jasmin ». « Vraiment, je trouve cela admirable. Je ne suis pas mécontent quand je m’entends », affirme-t-il, avec un sourire malin.
Puis il raconte que c’est lorsqu’il était prisonnier de guerre en 1942-1943 que lui vint l’envie d’écrire. Ne disposant d’aucun matériau, il écrivit ses premiers textes sur un sac d’engrais. Après la guerre, il commence à publier sous le pseudonyme de Maurice Igor et écrit des paroles de chansons : « Ma chérie, mon amour, / Dans mes bras tu cueilleras tes plus beaux jours… » « J’ai été chanté ! » assure-t-il. Ses premiers poèmes furent rédigés dans des cafés, endroits qu’il affectionnait particulièrement.
Il rappelle comment son père, José de Obaldia, surgit soudain de nouveau dans sa vie. Après le succès des Richesses naturelles (1951), sa mère écrivit à son père, qui était devenu ministre de l’Intérieur du nouveau président Arrias après la révolution au Panama. Son père félicita ce fils qui avait reçu la Croix de Guerre (« sans le faire exprès », dit-il), comme s’il ne l’avait jamais quitté. Il mourut quelque temps après.
C’est seulement à l’âge de 54 ans que René de Obaldia ira au Panama. Il y retrouvera cette nombreuse famille lointaine, composée de commerçants, de politiques, de docteurs, qui le fête et l’accueille dans de vieilles maisons coloniales. Il en éprouvera une grande émotion et il avoue : « C’est comme si j’avais enfanté cette famille. »
René de Obaldia évoque ensuite la 8ème merveille du monde, le canal de Panama, qui représente l’union du Pacifique et de l’Atlantique. Le dramaturge est émerveillé devant la réalisation de ce rêve ancestral. Il rappelle Ferdinand de Lesseps, les 28 000 hommes, morts dans cette construction, longue de 35 années, et son grand-père, le général José Domingo de Obaldia, qui en supervisa les travaux. Il fait le constat que l’homme est un bien étrange animal, capable du meilleur comme du pire.
Ce voyage sur la terre de ses ancêtres est pour l’écrivain l’occasion de revenir sur l’histoire de sa famille, d’origine espagnole, qui osa le voyage périlleux vers le Vénézuela, puis le Panama. Ainsi sa famille compte un gouverneur, un président, un général au service de ce pays. Un de ses grands-oncles construisit aussi le Teatro Nacional. L’Espagne est très présente en lui, qui voue une grande admiration à Cervantès et à Calderon.
C’est ensuite au tour d’Olivier Norra de parler de son ami Obaldia. Il souligne sa capacité, toute faite d’une ironie subtile, à faire sauter l’hypocrisie de l’époque, sa volonté de lutter contre toutes les conventions. « Il se fout de vous », affirme-t-il. Il insiste sur son sentiment tragique de la vie, sa politesse du désespoir. Il conclut que son humour résulte d’une surabondance de gravité.
En 1951, Obaldia avait fait paraître Les Richesses naturelles. En 1979, il prend tout le monde à contrepied avec La passion d’Emile. Il y met en scène les souffrances de la paternité, un sujet peu traité selon lui. Il y parle de la vacuité du père au moment de la naissance, de son sentiment d’exclusion, de sa douleur métaphysique, tous sentiments propres à le rendre fou. Il embarrassera tout le monde, et l’Eglise au premier chef, en disant : « Il est plus naturel de tuer son voisin que de mettre au monde. » En effet, à partir du moment où l’on est persuadé de l’existence de l’Enfer, comment peut-on accepter de donner la vie à des êtres qui seront voués à la damnation éternelle ?
En 1963, Le satyre de la Villette, avec Sami Frey, fait scandale. Puis, sa pièce, Au pays d’Eudoxie, s’attire la réprobation générale et il est alors considéré comme un écrivain obscène. Mise en scène par René Barsacq, elle ne tiendra l’affiche que pendant douze représentations. Huit ans plus tard, retransmise à la télévision, elle sera encensée ! Et pourtant, elle y dénonce le pouvoir de ce média, créateur d’une « assemblée de muets », ce « chewing-gum pour l’oeil », favorisant le somnambulisme de ceux qui la regardent. En 1993, invité à Bouillon de culture pour son Exobiographie, Obaldia y mettra d’ailleurs en garde contre la vedettisation des présentateurs de la télévision. Comment est-il possible qu’on fasse des vedettes de ceux qui racontent des catastrophes à la télévision ? Il faut vraiment être dégénéré pour en arriver là !
Ensuite, ce sera l’immense succès de la pièce, Du vent dans les branches de sassafras, avec Michel Simon. Commentant sa carrière, l’acteur disait ainsi avec fierté : « Commencer avec Pirandello et finir avec Obaldia, ce n’est pas si mal. » Cependant, l’auteur admet que cette pièce, écrite en 1968, en marge de ses activités littéraires, avait constitué une gageure. « L’énorme présence de Michel Simon suppléait au rétrécissement du texte », commente-t-il. En effet, s’il arrivait au comédien de dire les répliques d’une autre pièce, sa présence fantastique faisait taire le public. Un soir, au moment des saluts, il oublia même le nom de Obaldia : « La pièce est de … Merde, j’ai oublié le nom de l’auteur », s’exclama-t-il. Un fait unique dans les annales du théâtre. L’acteur s’amusait encore, lorsqu’il disait à l’auteur : « Vous n’avez pas écrit cette pièce pour moi, vous l’avez écrite pour Noël Roquevert ! » Et longtemps, les gens crurent même qu’elle avait été écrite pour Michel Bouquet.
Michel Bouquet, encore un acteur génial, qui créa le personnage de savant indersidéral de Monsieur Klebs et Rosalie. Le comédien venait répéter le matin et même l’après-midi, afin de répéter les gestes de ce héros qui fabrique des machines extraordinaires. Michel Bouquet avoue avoir craint de manquer de modernité devant la démesure anormale du texte. Mais à travers ce délire verbal extravagant, il a découvert une vérité intérieure considérée dans le plus infime détail, que le dramaturge parvient à restituer dans toute sa théâtralité.
Obaldia reconnaît que la création est quelque chose d’éminemment mystérieux, allié à un grand pouvoir de solitude. Et son ami Pierre Norra, avec qui il entretient une camaraderie de galopin, admire son esprit universel, empreint d’humanité, un esprit qui permet la rencontre. C’est d’ailleurs peut-être en captivité que le dramaturge a découvert cette notion si essentielle à la survie. « Là-bas », explique-t-il, « seul comptait l’Etre et l’on voyait d’emblée celui qui possédait cette notion d’humanité », génératrice de réconfort.
Mais Obaldia parle peu de la guerre, de cette expérience de la captivité qu’il connut dans un stalag à Sagan. Dans cette briqueterie où il travaillait, ce fut une expérience humaine inoubliable, en même temps qu’elle fut à l’origine de son pessimisme foncier. Dans une telle situation, «on n’a plus qu’à se flinguer ou à essayer d’avoir de la distance avec un destin singulier ». Selon lui l’Homme ne s’améliore pas et le vieil adage, « Homo homini lupus », est plus que jamais d’actualité. Il dit aimer se promener dans les cimetières, imaginer les différents morts afin de conjurer le sort. Et de citer Cocteau : « La mort, j’y suis habitué. Avant ma naissance, j’étais mort depuis si longtemps ! » Il évoque encore Leonard Bernstein répondant à Jacques Chancel qui l’interrogeait sur l’après : « Non, je suis formel, il ne se passe rien : e finita la comedia ! Enfin, on verra bien… » Une attitude que René de Obaldia fait sans doute sienne.
Toujours est-il que son oeuvre séduit un public de tous âges. Cyrielle Claire, qui a joué La grasse matinée en 2009 (créée en 1977), dit avoir lu tout Obaldia. Elle en aime la poésie et cet humour qui transcende nos peurs, celui d’un écrivain qui fait des suggestions sur la vie après la vie. Elle apprécie encore l’humilité d’un auteur pour qui l’oeuvre est plus importante que le je, et que le nombrilisme insupporte.
Car ce qui intéresse au plus haut point le dramaturge, c’est ce dédoublement mystérieux que l’oeuvre représente. La mort, l’enfance, la religion ne s’y côtoient-elles pas dans la douce anarchie des souvenirs d’enfance ? Obaldia se plaît à évoquer sa grand-mère Honorine, du temps où elle lui faisait faire sa prière du soir. Mystique alors, il se frappait la poitrine en de grands mea culpa qui faisait rire son aïeule. Et quand il évoque les apôtres, il les décrit comme « de pauvres hommes qui vivaient avec Dieu en plein capharnaüm ».
Toujours plein de gaieté, Obaldia s’amuse de la lettre reçue d’une petite fille, lectrice de ses Innocentines, et admiratrice du « zizi perpétuel ». « Et moi, Zaza, je n’en ai pas ! » Il rit d’avoir reçu en 1993 un Molière d’honneur pour Monsieur Klebs et Rosalie en même temps que le Molière du meilleur auteur : « Je ne pouvais plus serrer la main de mes amis à la sortie ! » C’est là qu’il évoque avec Michèle Morgan, cousine de sa mère, leur première rencontre alors qu’il avait quatorze ans. Et elle, qui était âgée de dix ans, avoue avoir été, à cette époque, amoureuse de son frère aîné José, qui était beau comme un dieu.
Puis, Obaldia s’attarde sur son épée d’académicien et la détaille. Des pierres de lapis-lazuli rappelant le canal de Panama, deux plaques de rubis symbolisant le rideau de scène, une sphère formant la garde, le blason de sa famille, tous ces éléments constituent une épée identique à celle des Gardes républicains. « Miracle, je me sens reverdir », dit l’académicien devant son costume aux palmes vertes, incité qu’il se sent à de nouvelles anabases.
Enfin, on le voit de retour au Panam, quarante ans après sa première visite. Il sourit malicieusement à l’idée que la maison de ses ancêtre, devenue musée national, ait été récemment cambriolée, illustrant ainsi le côté tragique et le côté comique de la vie. En visite à l’université d’Oteima, à des universitaires qui lui décernent le titre de docteur honoris causa et qui lui demandent le secret de sa longévité, il répond qu’il lit chaque matin une page d’un certaine Obaldia. Et devant le Teatro Nacional, il déclare être persuadé que le théâtre continuera d’être spectacle vivant. Et il rappelle la réponse d’une petite fille à qui on demandait si elle préférait le théâtre ou le cinéma et qui avait dit : « Le théâtre ! Parce
que, au théâtre, j’ai toujours peur que la dame perde sa chaussure ! » Il souligne ainsi la primauté d’un art qui privilégie la magie de l’instant.
Il y a vingt-cinq ans, Obaldia craignait de déboucher hagard sur l’an 2000, ainsi qu’il le dit avec sa drôlerie coutumière. Il est clair qu’il n’en est rien puisque, en 2009, ce « Paganini du cocasse » lisait en scène ses propres textes avec une verdeur inégalée. Il déclare avec flamme vouloir continuer le combat. Hanté par don Quichotte, il continuera à « voler au secours des veuves, des orphelines et des baleines en perdition. Rossinante continuera à briser tous les écrans de télévision de ses sabots étoilés ». Et ce sera l’imaginaire qui triomphera de la triste réalité. Et même s’il conclut : « L’homme est comme Dieu l’a fait, et bien souvent pire ! », René de Obaldia demeure un éternel don Quichotte du théâtre.






















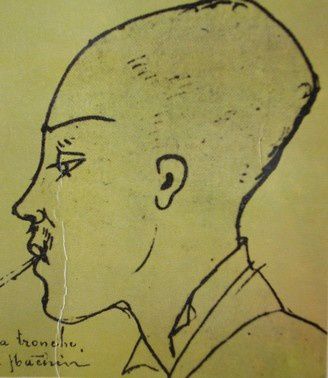









/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)
