
Larissa Fiodorovna Antipova (Julie Christie)
et Iouri Andréiévitch Jivago (Omar Sharif),
dans le film de David Lean, Le docteur Jivago
(Photo Allo-Ciné)
J'avais vu il y a bien longtemps le film de David Lean, Le docteur Jivago et, comme beaucoup je le pense, j'avais gardé en mémoire le beau visage sensuel et grave de Julie Christie dans le rôle de Lara et le regard fiévreux et méditatif d'Omar Sharif, l'interprète de Youri Andréievitch Jivago. Ne surnageaient dans mes souvenirs que cette histoire d'amour et de douleur.
Or, à la lecture de l'œuvre de Pasternak, il me semble que l'essentiel est peut-être résumé dans cette passion faite de paradoxes et que, d'une certaine manière, elle reflète toutes les ambiguïtés de la révolution russe, par ailleurs si bien dépeinte dans le roman. L'écrivain russe qui déclarait « Ne pas choisir, surtout ne pas choisir », propose ici un roman d'amour qui apparaît comme une fable symbolique. Le médecin poète, « intellectuel à l'échine docile », pétri de paradoxes, qui condamne et accepte la violence, est le reflet des tourments d'un auteur, « équilibriste entre sa chère Russie et le bolchevisme ». Tout comme peut l'être aussi Lara, Larissa Fiodorovna Antipova, « celle qui porte une faille pour toute la vie », qui est déchirée entre sa faute originelle et sa pureté ; comme l'est encore son époux Pacha, Pavel Pavlovitch Antipov, alias Strelnikov, que son « don de pureté morale et d'équité », exempts de tolérance du cœur et d'intuition, mèneront aux pires excès.
Admirable roman qui n'est pas celui des « justes, ceux qui ne sont jamais tombés, qui n'ont jamais fait un écart. » Pour ceux-là, « leur vertu est morte, elle a peu de prix. » En effet « la beauté de la vie ne [leur] a pas été révélée » (p. 511). Un des thèmes récurrents de Pasternak n'est-il pas celui de la vie, déjà exprimé dans Ma sœur la vie ? Et Youri, alors qu'il critique « les promoteurs de la révolution [qui] n'aiment que le tohu-bohu et les chambardements, affirme : « L'homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre. Et la vie elle-même, quoi de plus précieux, de plus enivrant ? » (p. 385)
Amour de la vie, opiniâtreté à vivre, qui se trouvent remarquablement exprimés dans ce passage où Youri Jivago, de retour à Iouratine après ses dix-huit mois passés chez les partisans, assimile la Russie à Lara : « C'est une soirée de printemps. L'air est tout piqué de sons. Les voix des enfants qui jouent sont éparpillées un peu partout comme pour montrer que l'espace est palpitant de vie. Et ce lointain, c'est la Russie, cette mère glorieuse, incomparable, dont la renommée s'étend au-delà des mers, cette martyre, têtue, extravagante, exaltée, adorée, aux éclats toujours imprévisibles, à jamais sublimes et tragiques ! Oh, comme il est doux d'exister ! Comme il est doux de vivre sur la terre et d'aimer la vie ! Oh, comme l'on voudrait dire merci à la vie même, à l'existence même, le leur dire à elles, et en face.
Oui, Lara, c'est tout cela. Puisqu'on ne peut communiquer par la parole avec ces forces cachées, Lara est leur représentante, leur symbole. Elle est à la fois l'ouïe et la parole offertes en don aux principes muets de l'existence. » (p. 501).
On retrouve l'expression de cette conception au moment où le docteur Jivago contemple la forêt lors de son séjour forcé dans la milice des Bois. A la contempler, « c'est comme si l'esprit de la vie entrait à flots dans sa poitrine, traversait tout son être et faisait jaillir des ailes de son dos ». Il revoit le visage de Lara, dont il chuchote le prénom : « Et ce murmure s'adressait à toute sa vie, à toute la terre, à tout ce qui s'étendait devant lui, à l'espace illuminé par le soleil. » (p. 442).
Strelnikov, lorsqu'il rencontre pour la seconde et dernière fois Jivago à Varyniko, la veille de son suicide, reconnaît aussi à la jeune femme cette capacité à incarner les beautés et les tourments du monde. Evoquant son épouse alors qu'elle était lycéenne, il dit : « C'était une petite fille, une enfant, mais on pouvait déjà lire sur son visage, dans ses yeux, l'alarme du siècle, son inquiétude. Tous les thèmes de l'époque, toutes ses larmes et toutes ses offenses, toutes ses impulsions, tout son ressentiment accumulé et toute sa fierté étaient inscrits sur son visage et dans son allure, dans ce mélange de modestie virginale et de sveltesse audacieuse. On pouvait accuser le siècle en son nom, par ses lèvres. […] Cela ressemble à une prédestination, à un signe du destin. Il fallait posséder cela de naissance, y avoir droit. » (p. 588).
Ce don de la vie, Youri Jivago le possède aussi au plus haut degré, ainsi que le lui révèle Anna Ivanovna Groméko, la mère de son épouse Tonia, et qu'il guérit au début du roman. Reconnaissant son talent, elle lui dit : « Et le talent, au sens le plus haut et le plus vaste, c'est le don de la vie. » Et Youri l'exprime dans le poème qu'il écrit alors qu'il est victime du typhus « Deux petites phrases vaguement rimées l'obsè[dent] alors :
La joie de Le toucher
Il faut se réveiller
C'est ainsi qu'il revient à la vie : « Et l'enfer, la perdition, la mort sont heureux de Le toucher, mais aussi le printemps, et Madeleine, et la vie. Il faut se réveiller et se lever. Il faut ressusciter. » (p. 268).
De ce roman des ruptures, nombre de scènes demeurent en mémoire : l'arbre de Noël chez les Sventitski, quand Lara tire sur Komarovski, la danse du vieux Juif moqué par un jeune cosaque, le voyage hallucinant de Jivago et des siens vers Varyniko, la mort du jeune garde blanc tué par Jivago, la venue dans les lignes des partisans d'un malheureux, amputé du bras droit et de la jambe gauche par les Blancs en représailles, les nuits à Varyniko tandis que dehors hurlent les loups...
Toute l'œuvre m'apparaît marquée par ce quelque chose de radical que définit Youro Jivago devant son beau-père Alexandre Alexandrovitch : « Dans cette façon de tout pousser jusqu'au bout, sans rien craindre, il y a quelque chose de bien russe et qui nous est familier depuis longtemps. Quelque chose de l'implacable luminosité de Pouchkine, l'Annonciateur, de l'impeccable fidélité au réel d'un Tolstoï. »
Mais au-delà des douleurs des séparations amoureuses et des excès de la révolution, demeure cette foi en la vie que le poète Jivago exprime dans l'avant-dernier quatrain de « La noce », le onzième des vingt-cinq poèmes, qui clôturent le roman :
Et la vie, est-ce autre chose
Qu'un instant sans poids,
Que se fondre en tous les autres
Comme en don de soi ?
Les références renvoient à l'édition Folio, n°79



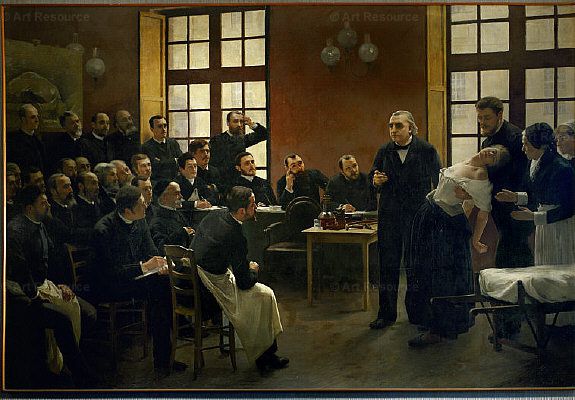










/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)
