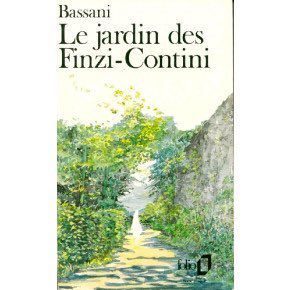
Il y a bien longtemps, j’avais vu le film Le Jardin des Finzi-Contini (titre original italien : Il giardino dei Finzi-Contini), un film italien, réalisé en 1970 par Vittorio de Sica. Librement adapté du roman éponyme de Giorgio Bassani paru en 1962, le film m’avait laissé un souvenir vif, notamment grâce à Dominique Sanda, dans le rôle mystérieux de Micòl Finzi-Contini.
Je viens de lire ce roman qui fut un grand succès lors de sa publication et c’est peu de dire que j’ai été passionnée par cette histoire, dont la plus grande partie se passe dans le jardin de la grande famille juive ferraraise des Finzi-Contini. Dans le contexte de la montée du fascisme en Italie, entre 1938 et 1943, le narrateur, qui appartient à la bourgeoisie juive de Ferrare, fait la chronique rétrospective et mélancolique d’un amour emporté dans les horreurs de la Shoah.
Encadré par un prologue et un épilogue, le roman se structure en quatre parties, le prologue créant d’emblée une atmosphère mortifère. C’est en effet la visite de la nécropole étrusque de Cerveteri, le long de l’Aurelia, « un dimanche d’avril 1957 », qui fait rejaillir chez le narrateur son désir ancien d’ « écrire sur les Finzi-Contini ». Se reportant aux premières années de sa jeunesse à Ferrare, il revoit alors « la tombe monumentale » de cette famille où seul le fils Alberto, né en 1915 et mort en 1942 d’une lymphogranulomatose, sera inhumé. « Alors que Micòl, la fille cadette, née en 1916, et son père le professor Ermanno, et sa mère la signora Olga, et la signora Regina, la mère paralytique et très âgée de la signora Olga, tous déportés en Allemagne au cours de l’automne 43, qui pourrait dire s’ils ont trouvé une sépulture quelconque ? » Oui, c’est bien la mort qui plane sur toute l’œuvre et lui confère cette aura si particulière.
Alors, pour échapper à cette menace diffuse, et dans ce contexte où germe l’antisémitisme, la famille Finzi-Contini se tient à part dans la synagogue, sort peu dans les rues de Ferrare, se nourrit des nombreux livres de sa majestueuse bibliothèque et vit en recluse dans son merveilleux jardin. Le père de Giorgio le narrateur critique son « affectation », son « orgueil héréditaire », « l’absurde isolement dans lequel ils vivaient ou, même, […] leur antisémitisme sous-jacent et persistant d’aristocrates ». Et comme le dira son père au narrateur vers la fin de la quatrième partie, c’est sans doute parce que Micòl était tellement autre que Giorgio en était tombé amoureux : « Ce sont des gens différents… ils n’ont même pas l’air de judim… Eh oui, je le sais : si elle, Micòl, te plaisait tellement, c’était peut-être pour cela… parce qu’elle nous était supérieure… socialement. » Et il lui dit aussi : « Dans la vie, si l’on veut comprendre, comprendre vraiment ce que sont les choses de ce monde, il faut mourir au moins une fois. »
En parallèle avec la montée du fascisme et les mesures antisémites prises contre les juifs ferrarais (exclusion du club de tennis, de la bibliothèque municipale…), le narrateur nous conte ainsi avec émotion son amour fou pour Micòl Finzi-Contini. Un amour né alors qu’ils étaient adolescents, qu’ils se jetaient des regards enfiévrés et furtifs sous le talèd de leur père respectif à la synagogue, ou encore que Micòl prenait place à la sortie des cours dans la voiture à cheval conduite par le vieux Perotti.
Dans la mémoire du narrateur, inoublié, demeure ce jour où ils se rencontrèrent de part et d’autre du mur du Barchetto del Duca et de la magna domus. Conseillé par l’adolescente, le garçon était descendu dans une angoissante chambre souterraine pour y cacher sa bicyclette et, quand il était remonté à l’air libre, Micòl avait dû abandonner son échelle, hélée par le cocher Perotti ou par son père. Il lui faudra attendre dix années avant de pénétrer dans le jardin enchanté des Finzi-Contini. Le narrateur évoque ici superbement le souvenir : « Combien d'années s'est-il écoulé depuis ce lointain après-midi de juin ? Plus de trente. Pourtant, si je ferme les yeux, Micòl Finzi-Contini est toujours là, accoudée au mur d'enceinte de son jardin, me regardant et me parlant. En 1929, elle n'était guère plus qu'une enfant, une fillette de treize ans maigre et blonde avec de grands yeux clairs, magnétiques. Et moi, j'étais un jeune garçon en culotte courte, très bourgeois et très vaniteux, qu'un petit ennui scolaire suffisait à jeter dans le désespoir le plus puéril. Nous nous regardions fixement l'un l'autre. Au-dessus d'elle, le ciel était bleu et compact, un ciel chaud et déjà estival, sans le moindre nuage. Rien ne pourrait le changer, ce ciel, et rien, effectivement, ne l'a changé, du moins dans le souvenir. » Si le narrateur devra attendre longtemps avant de pénétrer dans le jardin enchanté des Finzi-Contini, un lien ténu mais vivace se sera créé alors entre les deux adolescents, qui constituera la trame du récit.
En 1938,les lois antisémites ayant exclu les jeunes bourgeois juifs du club de tennis de la ville, Micòl et son frère Alberto vont les recevoir dans leur parc et sur leur court de tennis. Au cours des longues promenades dans le jardin où Micòl apprend à Giorgio le nom des arbres, au fil des visites que le jeune étudiant fait à Alberto et à sa sœur, se tisse une relation étrange et ambiguë où l’amitié se confond avec l’amour. Quand Giorgio prend conscience de la profondeur de son amour pour Micòl, celle-ci, de plus en plus inaccessible, se dérobe à lui et le rejette. La désillusion du jeune homme est immense.
Je me suis interrogée sur cette valse-hésitation que Micòl impose à Giorgio. Comment l’expliquer à un moment où la menace fasciste se fait plus présente ? Il me semble que, peut-être, l’attitude parfois incompréhensible de la jeune fille soit due à un besoin viscéral de se protéger de toute atteinte du monde extérieur. Nombreuses sont les fois où elle se plaint de devoir aller à Venise pour terminer sa maîtrise et on ne la voit jamais dans les rues de Ferrare. Tout comme Emily Dickinson, la poétesse américaine, sujet d’étude de Micòl, qui vécut recluse dans la maison familiale d’Amherts, elle demeure à part dans le grand jardin familial, avec son court de tennis, sa ferme et son arboretum. Dans la magna domus, la grande bibliothèque, la chambre d’Alberto, sa collection d’opalines lui servent de repères. Partout, l’accompagne Ior, le grand danois. C’est ainsi que Micòl est souvent représentée rêvant à sa fenêtre, métaphore de son refus de regarder la sombre réalité en face.
Pourtant les points communs ne manquent pas entre les deux jeunes gens, eux qui aiment tous deux la littérature italienne et Carducci, et qui possèdent une sensibilité à fleur de peau. Mais peut-être que Micòl considère Giorgio comme un vieil ami d’enfance : n’avait-elle pas elle-même souhaité placer une place commémorative sur le mur d’enceinte de leur rencontre, dédiée au « vert paradis des amours enfantines » ? N’est-elle pas encore guidée par un réflexe de classe envers un jeune homme d’une condition légèrement inférieure à la sienne ? Elle lui reproche surtout de ne pas savoir se dominer et lui assène avec dureté qu’ « étant donné les rapports qu’il y avait toujours eu entre [eux], [sa] manie de l’embrasser, de [se] frotter contre elle n’était probablement la preuve que d’une seule chose : celle de [sa] profonde sécheresse de cœur, de [son] incapacité constitutionnelle d’aimer vraiment ». Enfin, il se peut qu’elle ne supporte pas sa jalousie maladive, puisqu’il est persuadé qu’entre elle et lui il y a quelqu’un d’autre. Si, à la toute fin de la Quatrième partie, le narrateur laisse entendre que cet autre amoureux pourrait être leur ami commun, l’ingénieur communiste Giampi Malnate, rien dans le texte ne vient le confirmer. Giorgio, s’approchant de la Hütte, le vestiaire du tennis, où il croit trouver les deux amants, n’y entendra que le silence. Dans le film, Vittorio de Sica est allé plus loin en montrant Micòl et Malnate nus sous le regard de Giorgio. Je préfère de beaucoup le doute que laisse planer le roman qui ajoute encore au mystère de Micòl.
C’est dans le chapitre III de la Quatrième partie que Micòl s’expliquera sur son désamour pour Giorgio. Elle reconnaît qu’ils sont « stupidement honnêtes l’un et l’autre, semblables en tout et pour tout comme deux gouttes d’eau ». Comment auraient-ils pu « désirer sérieusement [se] déchirer ? » Puis elle envisagera avec une ironie cruelle la scène de leurs fiançailles à la synagogue : « Nous fiancer, peut-être avec accompagnement d’échange de bagues, de visites des parents, etc. ? « Quelle histoire édifiante […] Pouah ! » Sans doute est-elle guidée par une forme d'idéalisme qui lui fait craindre la banalité déceptive de la vie, lui interdisant tout engagement. Pressent-elle avec son âme de pythie que son destin sera tragique et que l'amour ne pourra la sauver ? Surtout, elle avouera à Giorgio, qu’à la différence des gens « normaux », leur manière commune de concevoir la vie est toute tournée vers le passé : « Elle le sentait très bien : pour moi, non moins que pour elle, ce qui comptait c’était, plus que la possession des choses, le souvenir qu’on avait d’elles, le souvenir en face duquel toute possession ne peut, en soi, apparaître que décevante, banale, insuffisante. Comme elle me comprenait ! Mon désir que le présent devînt tout de suite du passé, pour pouvoir l’aimer et le contempler à mon aise, était aussi le sien, exactement pareil. C’était là notre vice : d’avancer avec, toujours, la tête tournée en arrière. N’en était-il pas ainsi ? »
Passage capital, qui ne peut manquer de faire songer à Proust, et qui explique la conception littéraire de Bassani. Sophie Nezri-Dufour explique très bien cette obsession pour le passé, signe d’une « volonté névrotique de possession de l’existence ». Le texte est placé dans une « atemporalité », un passé mythifié et figé. Ce faisant « en éliminant la temporalité, Bassani élimine la menace qu’elle représente et l’empêche de voir la réalité telle qu’elle est ». Et ce temps suspendu, arrêté, ne permet pas non plus l’évolution des personnages. Micòl demeure inchangée dans le passé. C’est peut-être cela qui a fait dire que le roman est une critique de l’aveuglement des bourgeois juifs de Ferrare devant la montée des périls. Seul, Giorgio dans le roman évolue, tant et si bien que l’œuvre peut se lire comme un roman d’apprentissage.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce roman et notamment sur la thématique du jardin qui est au cœur de l’œuvre et lui donne son titre. C’est à ce lieu emblématique qu’est confiée la dimension consolatrice du passé : beau et immuable, le jardin échappe à la tyrannie du temps, précise Sophie Nezri-Dufour. De nombreux détails font de cet endroit un lieu de légende. Le jardin et la magna domus sont des lieux inaccessibles, Micòl habite la pièce la plus haute de la demeure, elle est toujours accompagnée de son gardin, le danois Ior, Tel un être à part, elle possède un langage particulier, le « finzicontinico » et prépare un breuvage céleste, le « Skiwasser ». Quant au sifflet d’Alberto qui appelle sa sœur dans le jardin, il est comparé à un « olifant ». Nouvelle Béatrice, Micòl est celle qui initie Giorgio aux arbres du jardin, comme Eve initiait Adam au Paradis. Puis elle le guidera à travers des cercles concentriques de la bibliothèque de son père à sa chambre haute, en passant par la chambre de son frère Alberto. Une ascension symbolique, prémonitoire de la chute. Car après le renvoi de Giorgio par Micòl, le jardin devient un enfer, préfiguration de l’enfer à venir.
Roman d’une grande richesse littéraire (nombreuses allusions à la littérature italienne et française), mythologique (connotations mythiques attachées aux lieux et aux personnages), historique (montée du fascisme, explications politiques), sociologique (description de la communauté juive de Ferrare avec ses coutumes et ses rituels), le roman de Bassani ne laissera aucun lecteur indifférent. Mais pour moi, au cœur du Jardin des Finzi-Contini, ce qui demeure, c’est le souvenir de Micòl, avec ses cheveux blonds, « de ce blond particulier et strié de mèches nordiques, de ce blond de fille aux cheveux de lin, qui était seulement à elle », l’amour perdu de Giorgio Bassani à qui il a dédié son roman.

Dominique Sanda dans le rôle de Micol Finzi-Contini
































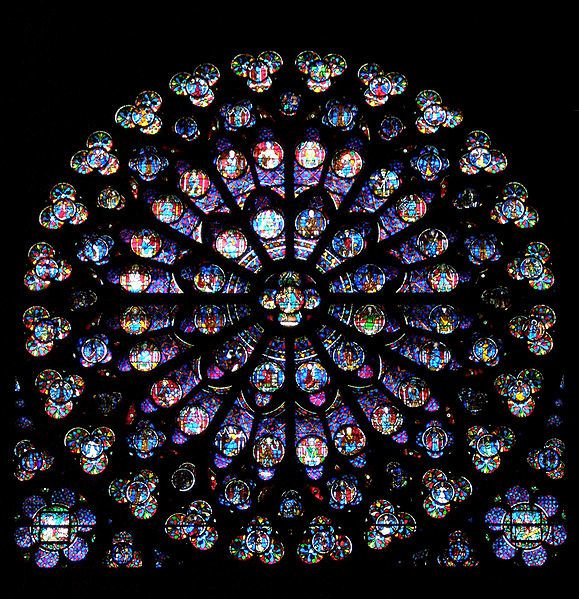
/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)
